Lire Lolita à Téhéran, scolaire mais bouleversant
La chronique du jour revient sur le film « Lire Lolita à Téhéran », réalisé par Eran Riklis. C’est directement adapté du roman autobiographique du même nom d’Azar Nafisi, écrivaine et professeur iranienne, exilée aux Etats Unis.
Faire référence à un roman – « Lolita » de Nabokov – dans le titre du long-métrage, c’est annoncer sans ambages la place que se veut tenir la littérature au sein de l’œuvre. Et on ne va pas s’embarrasser, le film est segmenté comme une bonne vieille dissert de français. Intro, développement en quatre parties et conclusion.
Chacune des parties est nommée en fonction d’un roman de la littérature et correspond à une année précise.
L’introduction, c’est le retour d’Azar à Téhéran en 1979. C’est le début de la révolution iranienne, et comme de nombreux·euses Iranien·nes, elle revient pleine d’espoir après la chute du Shah. Mais rien que la fouille de sa valise à l’aéroport nous renseigne sur le climat ambiant et la haine portée aux femmes, surtout si elles portent du rouge à lèvres et lisent des livres.
La partie 1 « Gatsby Le Magnifique » se déroule en 1980, une année après l’introduction. Azar enseigne la littérature anglo-saxonne à l’Université et se heurte déjà à une forme d’opposition de certains étudiants masculins qui réclament des œuvres dites morales.
« Les livres sont faits pour nous incommoder et remettre en question nos croyances. » répondra Azar mais ça sent le début de la censure, l’arrivée du port obligatoire du voile et les arrestations.
Partie 2 « Lolita » : on retrouve Azar en 1995, donc 15 ans après. Elle a décidé de donner des cours de littérature clandestins à des femmes, ses anciennes étudiantes, dans son salon en dépit des risques encourus.
Partie 3 « Daisy Miller » : on repart en arrière, nous sommes en 1988, donc 8 ans après la partie 1, mais 7 ans avant la partie 2. Accrochez-vous!
Les bombes pleuvent sur la ville, c’est la guerre avec l’Irak. Azar enseigne de nouveau à l’université d’Allameh. Mais un drame la pousse à la démission.
Partie 4 « Orgueil et préjugés » : on saute en 1996 soit un an après la partie 2 qui se déroulait en 1995. Vous suivez toujours ?
Les cours de littérature secrets continuent avec toutes les difficultés que cela pose pour ces femmes qui ont des pères ou des maris plus ou moins emballés par le concept.
Conclusion : nous sommes en 2003 à Washington où Azar et sa famille ont trouvé refuge.
Alors vous l’aurez compris, on est sur une mise en scène un peu scolaire. Avec une narration non chronologique qui embrouille un peu le récit et le suivi des événements sans que ce choix n’apporte vraiment quelque chose de plus pour l’intrigue ou l’arc narratif du personnage principal. Néanmoins, cette mise en scène simple permet de bien développer le propos politique et le portrait de cette société iranienne où les femmes sont les principales victimes de l’oppression et des violences.
La violence est très présente mais très peu montrée, on l’entend, on la sent, on la comprend. Il y a des scènes de détention et de torture d’une tension qui vous met les nerfs à rude épreuve. Sans rien voir, on sait très bien ce qui est à l’œuvre et c’est terrifiant.
Mais on n’a pas encore parlé de Lolita, de Gatsby ou de Daisy… Pour un film qui fait explicitement appel à des œuvres de littérature, c’est finalement assez peu utilisé. Soit c’est très explicite : « il est écrit ceci dans ce livre, comment est-ce que ça se rapporte à notre situation personnelle » soit il n’y a pas de traitement ; ce n’est pas quelque chose qui va donner corps à la partie du film en question, la guider, lui donner une profondeur.
Les dialogues sont assez plats, pas vraiment incisifs, on ne sait pas trop où ça veut aller mais je me demande si ce n’est pas la faute des sous-titres français…
Le film est sauvé car c’est le portrait d’un pays, d’une situation, c’est un manifeste politique et féministe important. Et surtout c’est porté par une galerie de personnages féminins bigrement bien interprétés, par des actrices iraniennes, vivant elles-mêmes en exil aux quatre coins du monde et donnant une grande authenticité à leur jeu. L’actrice Golshifteh Farahani dans le rôle principal, lumineuse, touchante, laisse exploser tout son talent dans une scène de climax à vous tordre les boyaux.
Un film au message bouleversant, brillamment interprété, qui explore, sans vraiment approfondir, le pouvoir de la résistance et de l’émancipation par la littérature.
–
Chronique : Sophie
Animation : Emma
Réalisation : Laure et Christian
Première diffusion antenne : 31 mars 2025
Crédit photo vignette : Metropolitan Films
Crédit photo fond : Libération
Mise en ligne : Sophie
Publié le 7 avril 2025
Un contenu à retrouver également sur l'application PlayPodcast

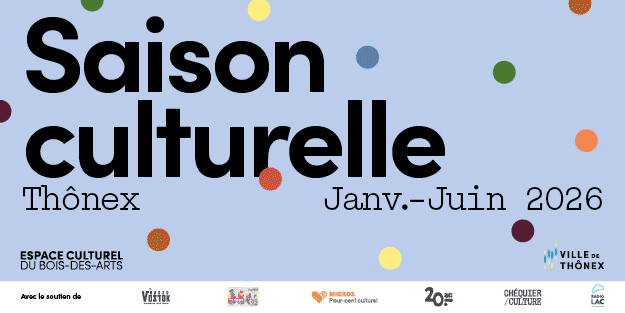





Commentaires
Pas encore de commentaire pour cet article.