Je suis toujours là : le combat d’une femme pour la vérité
Aujourd’hui, on parle du film phénomène au Brésil avec ses 3 millions d’entrées, « Je suis toujours là ». Mais c’est aussi un succès hors de ses frontières avec le Prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise ; le prix de la meilleure actrice aux Golden Globes pour son actrice principale, Fernanda Torres, et en lice pour les Oscars dans les catégories : meilleur film ; meilleur film international et meilleure actrice, toujours pour Fernanda Torres. Personnellement, j’aurais créé une catégorie : meilleur titre de film qui permet des jeux de mots à l’infini.
Alors ce nouveau film de Walter Salles sent bon le sable chaud. Enfin seulement au début. À Rio, on fait la connaissance de la famille Paiva à la plage, entre baignade et beachvolley. Eunice et Rubens, la quarantaine, sont un couple aimant et soudé, les fiers parents de cinq beaux enfants. La maison familiale à deux pas de l’océan est le lieu des rencontres, des ami·es, des jeux et des diners conviviaux.
Sauf qu’on est en 1971, sous la dictature militaire. L’étau se resserre jusqu’au jour où des hommes armés sonnent à la porte et embarquent Rubens. La suite de l’histoire suivra Eunice et ses enfants dans leur lutte pour connaître la vérité sur cette disparition et sur la nécessité de se reconstruire malgré le vide.
L’esthétique du film est très belle avec les ajouts d’images super 8 prises par la caméra de la fille aînée, les filtres sépia et les photos de famille. Ça filme très près, parfois caméra à l’épaule pour une immersion totale au plus près des personnages. Ce n’est sans doute pas d’une originalité folle pour un film qui retrace une odyssée familiale entre 1970 et 2014 mais ça fait son petit effet. En tout cas, ça plante l’ambiance et le décor. Mais surtout ça permet de créer un contraste de lumière avec la suite. Si celle-ci est très présente au début, avec le soleil à la plage ou à la maison, la lumière disparait lors des événements graves qui touchent la famille. Cette lumière parait reliée à Eunice elle-même et elle va disparaitre, réapparaitre, se transformer au fil des événements qui la touchent et de ses états d’esprit. Des rideaux fermés des fenêtres aux murs de prison, l’obscurité gagne du terrain mais ne gagnera jamais totalement sur cette femme résiliente.
Moi qui suis friande de films au contenu politique, je suis un peu restée sur ma faim… Déjà, si vous n’avez pas de connaissances préalables sur la situation du Brésil dans les années 70, vous pouvez vous sentir un peu confus·e. Il n’y a pas vraiment de contexte, ni d’explications. Mais c’est facilement arrangeable avec un petit tour sur le web avant d’aller au ciné.
La seconde raison tient au choix d’écriture. C’est inspiré d’une histoire vraie, celle de la disparition de cet ancien député socialiste, et adapté du roman qu’écrira son propre fils, Marcelo. Donc logiquement l’intrigue se centre sur la famille Paiva et les conséquences affectives, émotionnelles, sociales et financières de l’absence du père. C’est la ligne de crête de l’opus politique : resserrer sur le drame d’une famille permet de toucher au cœur le public et d’ancrer l’horreur de la dictature dans des circonstances concrètes que tout le monde peut se représenter. Tout en sachant que ce focus passe sous silence, le collectif, la résistance, le sort des moins bien nanti·es, qui ne sont pas d’une famille bourgeoise, oubliant donc ce qui s’est passé pour tous·tes les autres.
Mais là où le film est malin, c’est dans le traitement d’un de ses enjeux qui porte sur la question des plus jeunes enfants d’Eunice et de ce qu’il convient ou non de leur dire de la situation. En choisissant de taire, en partie, la situation à ses cadet·tes, en imposant le silence dans sa propre maison, Eunice ne répète-t-elle pas le schéma de violence et d’absence forcée des dictatures ?
Comme c’est une odyssée familiale, après les années 70, on saute directement en 1996 puis en 2014. Je trouve que ce qu’il se passe dans ces années passées sous silence – le silence encore lui – aurait mérité d’être raconté. Un peu plus d’ailleurs que certaines longueurs de la partie du film centrée sur les années 70.
Avec la difficulté technique des ellipses : est-ce qu’on change les acteurs et actrices au risque de perdre le public qui doit rapidement comprendre qui est qui – je vous rappelle qu’il y a 5 enfants ? Ou est-ce qu’on vieillit les mêmes ? Le choix qui a été fait pour jouer Eunice Paiva de 2014, c’est de prendre l’actrice Fernanda Montenegro qui n’est autre que la mère de l’actrice Fernanda Torres. C’est bluffant, on dirait elle. Et d’ailleurs Fernanda Montenegro avait aussi été nommée aux Golden Globes et aux Oscars en 1999 pour son rôle dans « Central do Brasil » réalisé par je-vous-le-donne-en-mille… Walter Salles.
Vu que je suis toujours là mais plus que pour quelques secondes, je conclus : une émouvante chronique familiale qui manque un peu de corps au niveau politique mais qui arrive quand même à point nommé pour comprendre le passé et éviter de le répéter.
–
Chronique : Sophie
Animation : Emma
Réalisation : Marlon et Noé
Première diffusion antenne : 11 février 2025
Crédits photos : UniFrance
Mise en ligne : Sophie
Publié le 18 février 2025
Un contenu à retrouver également sur l'application PlayPodcast

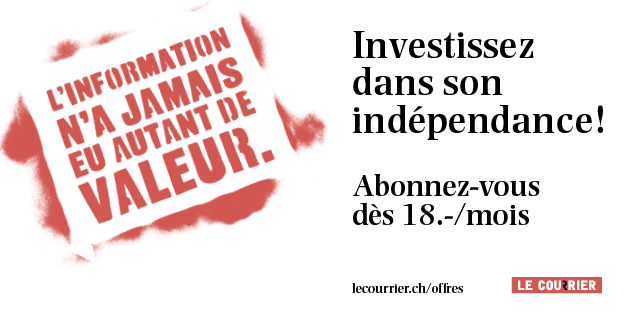





Commentaires
Pas encore de commentaire pour cet article.