Ceci est mon corps: la caméra contre le silence
En 2018, l’affaire Olivier de Scitivaux bouleverse Orléans. Ce prêtre, ancien recteur de la basilique de Cléry-Saint-André, est inculpé. Six ans plus tard, il sera condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineurs.
Parmi ses victimes: Jérôme Clément-Wilz, cinéaste. Cette même année, il porte plainte pour des faits commis entre la fin des années 90 et début 2000.
De cette démarche naîtra Ceci est mon corps, disponible sur Arte depuis début octobre. Un film qui m’a complètement bouleversée.
Cette action marque un tournant pour le réalisateur. Des fragments de ses souvenirs resurgissent. Il décide alors de documenter chaque étape, jusqu’au procès. Au début, il saisit sa caméra presque par instinct, pour ne pas se laisser engloutir. Et puis, lorsqu’il apprend qu’il y a d’autres plaintes, d’autres victimes, il se met en quête de vérité. Après six ans, il gardera une heure d’images, amplement suffisante pour former ce témoignage essentiel.
Le visage d’Olivier de Scitivaux reste quasiment inconnu, on le devine à peine sur de vieilles photos. Le film se concentre ailleurs: sur la parole, la mémoire, la reconstruction. Le véritable sujet, c’est la solitude. Celle des victimes face au malaise de leur vécu, celle d’une parole qu’on n’entend pas, qu’on ne veut pas entendre. Le sentiment d’abandon face au déni.
La caméra se tourne beaucoup vers les parents de Jérôme. Il les filme chez eux ou lors de leurs entretiens en visio. On apprend, en même temps que lui, qu’ils savaient. Que leur fils les avait prévenus, lors d’un repas de famille.
Lorsqu’il les confronte, leurs réactions sont effarantes: mutismes, balbutiements, voire même une forme d’empathie pour l’agresseur. Sa mère va jusqu’à douter de sa parole. Elle le soupçonne d’exagérer pour alourdir la peine de l’ancien prêtre.
Forcément, derrière notre écran, on est horrifié. Mais le film ne cherche jamais à juger. Il montre plutôt l’incapacité de ceux qui savaient, à affronter la vérité.
Ce silence, Jérôme le retrouve ailleurs: au sein de l’église, où plusieurs femmes de l’aumônerie avaient tenté d’alerter, dès les années 80. Elles racontent qu’elles ont dû surveiller de Scitivaux pendant des années, sous l’ordre de l’évêché. D’autres ont fini par démissionner, impuissantes.
Dans une interview accordée à France Inter, Jérôme Clément-Wilz déclare: «Quand on dit par exemple qu’en ce moment c’est la libération de la parole, ce n’est pas vrai. Les victimes ont toujours parlé : c’est juste que personne ne les a écoutées».
Le monde semble paralysé. C’est vertigineux. Tant de signaux, tant de plaintes, et si peu d’action.
D’autant plus terrible qu’on sait que l’Église a couvert, pendant des décennies, d’innombrables affaires semblables.
Le film navigue entre le passé et le présent: des images d’archives sur VHS où l’on voit Jérôme enfant – chez lui ou à l’église –, et des séquences plus contemporaines. On le retrouve en train de questionner ses parents, de s’entretenir avec ses avocats, de fouiller ses photos, ses lettres, son dossier médical. Il retourne à Orléans. Il revient au presbytère et découvre les salles, les toilettes, les matelas, où il a enduré les sévices. Les pièces sont vides, silencieuses, mais lourdes de ce qui s’y est passé.
Les couleurs froides, les lumières blafardes, le carrelage des sols: tout évoque une sorte d’hiver permanent. Par moment, une ironie glaçante traverse l’image: un zoom sur une inscription religieuse – «Dieu nous attend, nous comprend, nous pardonne» –, ou sur un vitrail montrant un homme tenir la main d’un enfant. Ces images banales deviennent insoutenables.
Le titre, Ceci est mon corps, résonne évidemment avec la liturgie catholique. Mais ici, il prend un autre sens : celui d’un corps brisé qu’on tente de réapproprier.
Jérôme parle d’ailleurs de “handicap”: il explique que ces violences laissent une marque durable, un handicap émotionnel et physique qui empêche d’évoluer “comme les autres”.
Et malgré tout, il y a une immense pudeur dans sa manière de filmer. Pas de colère, pas de désir de vengeance. Juste la lucidité d’un homme qui refuse que son histoire soit enterrée.
C’est là que réside, paradoxalement, la beauté de ce récit. Dans la capacité de Jérôme à parler de ce qu’il a vécu sans haine, à chercher non pas la revanche, mais la paix. Il est beaucoup question de pardon, d’amour même — pas de celui qu’on ne questionne pas, mais de celui qu’on reconstruit, petit à petit, pour soi, pour continuer à vivre.
Un documentaire qui laisse K.O., sans bruit ni fracas, avec une émotion sourde qui continue de résonner.
–
Chronique : Judith
Animation : Lionel
Réalisation : Alexis
Crédit photos : Arte
Première diffusion antenne : 28 octobre 2025
Publié le 1er novembre 2025
Un contenu à retrouver également sur l'application PlayPodcast

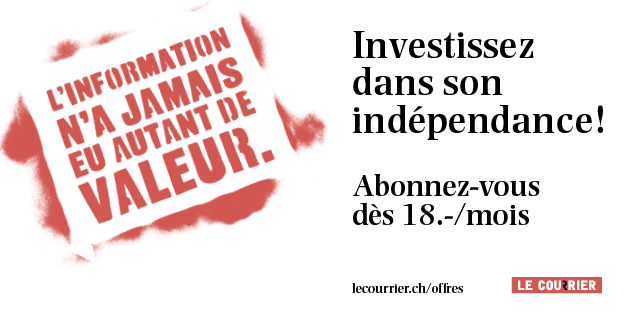





Commentaires
Pas encore de commentaire pour cet article.